Lorsqu’on se propose de développer un programme étymologique, il faut commencer par se demander comment les langues évoluent. Il existe à ce sujet un grand nombre de théories dont nous aimerions donner un bref aperçu.
En 1785, le linguiste anglais William Jones (1746-1794) émet l’hypothèse que le sanscrit, le latin et le grec, vu les ressemblances frappantes qui existent entre eux tant au niveau des racines verbales que des formes grammaticales, « ont jailli d’une source commune, peut-être disparue »(1). Par cette remarque, il anticipe ce que plusieurs générations de chercheurs essaieront de démontrer après lui. A partir de 1800, on constate, en effet, une augmentation considérable de l’intérêt pour la langue sanscrite. Cet intérêt est à la fois cause et effet de plusieurs publications qui paraissent dans ces années-là(2).
A peine dix ans plus tard, en 1816 pour être exact, Franz Bopp (1791-1867) publie une thèse intitulée Über das Coniugationssystem der Sanscritsprache in Vergleichung mit jenem der griechischen, lateinischen, persischen und germanischen Sprache, ouvrage dans lequel il démontre l’appartenance de toutes ces langues à une seule et unique « famille » qui dérive d’une hypothétique langue « mère » et qui sera bientôt appelée l’« indo-européen »(3). Pour la première fois, la recherche n’est pas basée sur des ressemblances lexicales, mais porte uniquement sur l’organisme grammatical, ce qui évite le risque d’établir des parentés entre des langues qui, non apparentées en réalité, ont de nombreux mots en commun suite à des emprunts que chacune a faits dans le lexique de l’autre(4). L’ouvrage de Bopp est considéré comme le premier travail de grammaire comparée, encore que, du point de vue strictement chronologique, il ait été devancé par le danois Rasmus Rask (1787-1832) qui, un an plus tôt, avait lui aussi appliqué la méthode comparatiste, quoique sans recourir au sanscrit, dans son Investigation sur l’origine du vieux Norrois ou Islandais (qui ne sera publié qu’en 1818).
Les publications se succédant coup sur coup, Jakob Grimm (1785-1863) contribue à son tour aux recherches historiques initiées par Bopp et Rask, en publiant en 1819 le premier volume de la Deutsche Grammatik. Ce titre prête à confusion dans la mesure où Grimm n’entend pas l’adjectif « deutsch » dans un sens restreint, mais le considère comme synonyme de « germanisch ». La Deutsche Grammatik, loin de se limiter à l’allemand à proprement parler, est donc, pour l’essentiel, une étude comparative de la famille des langues germaniques.
Les principales nouveautés de cet ouvrage sont les fameuses « correspondances phonétiques » qui, plus tard, seront appelées la « loi de Grimm »(6). Cette « loi » (notion sur laquelle nous reviendrons) n’indique pas seulement les formes sous lesquelles le « même » son est censé apparaître dans les différentes langues (cf. gr. pathr, lat. pater, sanscr. pitar, got. fadar, angl. father, anc. all. fater pour les correspondances p-p-p-f-f-f et t-t-t-d-d-t), mais postule une « rotation circulaire » (« Kreislauf ») des sons qui tendrait à transformer continuellement les sourdes en aspirées, les aspirées en sonores et les sonores en sourdes, de sorte que le mouvement, d’après Grimm, serait éternel, sans début ni fin.
Chez Grimm, le terme « loi » (« Lautgesetz ») n’a pas encore la valeur absolue qui lui sera accordée plus tard par Schleicher et surtout par les néogrammairiens. Il est à comprendre comme une « tendance », une « règle générale » qui est respectée la plupart du temps, mais qui n’a nullement besoin d’être suivie dans tous les cas. Ainsi, en 1833, lorsque Pott publiera ses Etymologische Forschungen auf dem Gebiete der indogermanischen Sprachen, il considérera les « lois phonétiques » comme « le fil le plus sûr dans l’obscure labyrinthe de l’étymologie »(7), une espèce de guide donc, le meilleur qui soit, sans doute, mais qui en fin de comptes ne peut que fournir des indices.
Avec August Schleicher (1821-1869), la linguistique historique entre dans une nouvelle phase. Ce chercheur allemand qui, outre la linguistique, avait une passion pour les sciences naturelles (notamment la botanique) se met à élaborer ce qu’il appelle la « Stammbaumthéorie » (modèle d’arbre généalogique) qui suit les méthodes de classification par espèces et groupes que le naturaliste suédois Charles de Linné avait appliquées aux plantes un siècle auparavant(8). À part la botanique, Schleicher a aussi été influencé par la biologie, notamment la théorie darwinienne : en 1863, quatre ans après la parution de l’ouvrage De l’origine des espèces par voie de sélection naturelle du célèbre biologiste anglais, Schleicher publie une lettre intitulée Die Darwinsche Theorie und die Sprachwissenschaft(9). Deux métaphores se sont dès lors solidement installées dans la langue scientifique : celle, botanique, qui divise les langues en « branches » et « sous-branches » issues d’un « tronc » symbolisant la langue originelle, et celle, biologique, qui les classe en « familles » et « sous-familles » et qui désigne les rapports existant entre elles par des expressions généalogiques du type langue « mère », langue « fille » ou langues « sœurs ».
Pour Schleicher, la linguistique fait partie des sciences naturelles au même titre que la physique ou la chimie : comme le chimiste est en mesure de déterminer la composition chimique du soleil grâce à la lumière qu’il émet, le linguiste peut analyser le langage à travers les sons émis par l’appareil phonatoire(10). Schleicher considère donc le langage comme un phénomène biologique ou physique qui est complètement indépendant de l’individu. C’est dans ce sens qu’il écrit que les langues sont des « organismes naturels » qui, « sans être déterminés par la volonté des hommes, naissent, croissent et atteignent leur maturité [..], et puis vieillissent et meurent »(11).
La conception naturaliste de Schleicher a comme conséquence que les « loi phonétiques » changent, elles aussi, de statut : de simples « tendances » chez Grimm, elles sont considérées de plus en plus comme des « lois naturelles universelles ». En partant de la prémisse d’une évolution soumise à des règles fixes et constantes, Schleicher conclut qu’il doit non seulement être possible de suivre un changement linguistique à travers le temps à partir d’une phase x pour aboutir à des phases x1, x2, ..., xn, mais également de reconstruire une phase primitive x non attestée moyennant la comparaison des phases attestées x1, x2, ..., xn (12). Convaincu de cette méthode, Schleicher tente de reconstruire la langue originelle des langues indo-européennes qu’il appelle le « proto-indo-européen »(13). Plus tard, il publiera même une fable reconstruite en proto-indo-européen.
La théorie de Schleicher a suscité de nombreuses polémiques, notamment en ce qui concerne ses reconstructions, et on lui a reproché son « biologisme » et sa vision « matérialiste » des choses. Mais même si beaucoup de ses théories se sont avérées trop « extrémistes », son apport à la linguistique a été décisif.
Après Schleicher, le dernier quart du XIXe siècle voit naître le mouvement des néogrammairiens, qui, comme aucun autre, a laissé ses traces dans l’histoire de la linguistique. En effet, aucune école linguistique n’a suscité autant de controverses et des réactions aussi polémiques et ardentes. Ceci est d’autant plus paradoxal que leurs thèses ne sont, à y regarder de près, pas aussi « innovatrices » et « révolutionnaires » que l’on a voulu les peindre : la plupart du temps, les néogrammairiens ne font qu’« expliciter les hypothèses tacites contenues dans les travaux de leurs prédécesseurs »(14). Leur contribution à la linguistique se présente donc, en premier lieu, comme une réflexion sur la théorie et la méthodologie scientifique. Les attaques violentes auxquelles leurs thèses ont, malgré tout, été exposées, s’expliquent donc plus par la manière provocante et « dure » dont les « nouveaux venus » (c’est ainsi qu’ils sont considérés par ceux qui, soudain, voient s’attribuer contre leur gré l’étiquette – peu flatteuse, en effet – d’« Altgrammatiker » par opposition à « Junggrammatiker ») expriment les principes de leur doctrine que par les propos à proprement parler défendus dans celle-ci.
Les principes de la théorie néogrammairienne se trouvent exposés, pour la première fois, dans un manifeste publié en 1878 par H. Osthoff et K. Bruggmann(15). Pour l’essentiel, il peut être résumé en deux thèses fondamentales : (1) les « lois phonétiques » ont, par définition, une valeur absolue, ce qui revient à dire qu’elles n’admettent pas d’exceptions; elles sont « aveugles » dans le sens où, à l’intérieur d’une même communauté linguistique, elles s’appliquent de manière mécanique à tous les mots, indépendamment des locuteurs; et (2) l’analogie ou d’autres facteurs d’ordre psychologique (tels que la préférence d’un mot au détriment d’un autre ou l’emprunt d’un mot dans un autre dialecte etc.) viennent « freiner » ou « perturber » l’action régulière des lois phonétiques. Pour les néogrammairiens, l’évolution de n’importe quelle langue se réduit donc à ces deux principes opposés : régularité (garantie par les lois phonétiques), d’un côté, et irrégularité (due à un facteur psychologique), de l’autre.
Si l’idée de la régularité (absolue) des lois phonétiques commence à prendre toujours plus d’importance, c’est que de nombreuses « exceptions » apparentes s’étaient révélées être des évolutions parfaitement régulières : Grimm avait constaté que le t du sanscrit présentait parfois des correspondances quelque peu insolites dans certaines langues (sanscr. bhratar (frère) et pitar (père), gr. jratwr et pathr, lat. frater et pater face à goth. broqar et fadar, all. Bruder et Vater; tandis que les premières correspondances semblaient donc « régulières » (t-t dans tous les cas), celles du gothique et de l’allemand (q-d et t-d) ne semblaient obéir à aucun système). En 1875, pourtant, Verner réussit à démontrer que ces différences étaient dues à la position de l’accent en indo-européen (en partant des formes sanscrites brátar et pitár, Verner suppose que l’indo-européen présente la même différence d’accent), qui bien que sans importance dans le cas du grec, du latin et du sanscrit, a pu donner des résultats différents en gothique et en allemand. Cette découverte le mène à postuler qu’« il doit exister une règle aux exceptions à une règle » et que « le seul problème est de la découvrir »(16).
Prétendre que l’évolution des langues suit des lois parfaitement régulières n’est pas une chose futile. Mais refuser à cet axiome, ne serait-ce qu’en relativisant le statut de la loi phonétique comme le font les adversaires des néogrammairiens, est, en effet, bien pire : car si le changement phonétique n’était pas régulier et que les mots soient soumis, au cours du temps, à des variations plus ou moins aléatoires, alors l’étude scientifique de l’évolution diachronique des langues serait a priori impossible et seuls les témoignages extralinguistiques pourraient nous fournir des informations sur les stades historiques antérieurs de ces langues(17).
Les néogrammairiens critiquent toute spéculation détachée des faits et issue d’une « atmosphère chargée d’hypothèses du laboratoire où l’on forge les formes-mères de l’indo-germanique »(18). Selon eux, le philologue doit quitter le « cercle brumeux » de la théorie, pour « émerger à la lumière de la réalité tangible et du présent, afin d’en tirer l’information que la théorie vague ne peut jamais fournir »(19). Ils favorisent donc le travail empirique, notamment dans le domaine de la dialectologie, pour se perdre – telle la critique qui leur a été faite – dans l’extrême d’un « examen minutieux des détails »(20).
Comme nous l’avons dit, les néogrammairiens s’intéressaient à la physiologie et à la psychologie, responsables qui des changements phonétiques, qui de l’analogie (ou de la résistance à la transformation phonétique régulière). Par analogie, il faut entendre, d’une manière très générale, « un rapprochement conceptuel d’une forme à une autre »(21). Tandis que pour la grammaire normative, le terme d’« analogie » était plus ou moins synonyme de « faute de grammaire »(22), il ne désigne, dans l’optique des néogrammairiens, qu’un facteur de plus dans l’évolution de la langue et dont l’unique différence par rapport aux lois phonétiques consiste dans le fait qu’il relève de ce qu’ils appelaient justement « la psychologie ». En effet, étant donné que les analogies obéissent, elles aussi, à des systèmes (qui, parfois, se laissent décrire explicitement comme des « attractions » sur l’axe paradigmatique, comme on dira dans la terminologie saussurienne), elles suivent également une certaine logique et ne sont donc pas aussi irrégulières qu’elles ne paraissent à première vue. Il se peut même que l’analogie se rapproche d’une loi phonétique au point qu’il est difficile de déterminer quel processus a été à l’origine du changement. Deux exemples peuvent illustrer ces propos.
En latin, il existait deux formes différentes du mot « honneur » au nominatif singulier : une forme primitive honos qui est remplacée plus tard par honor. Ce changement est dû à un phénomène d’analogie : dans une phase non documentée du latin, la déclinaison de ce mot devait ressembler à honos (nom.), *honosis (gén.), *honosem (acc.) etc., donc avec un s dans toutes les formes. A la suite du rotacisme, les s intervocaliques (et seulement ceux-là) sont devenus r, ce qui a donc donné la déclinaison « classique » telle que nous la connaissons : honos (nom.), honoris (gen.), honorem (acc.). A ce moment-là, vu que la plupart des noms términés en –oris au génitif avaient –or au nominatif (cf. cultoris – cultor, amoris – amor, furoris – furor etc.), le s de honos – la seule des douze formes, d’ailleurs, qui présentait ce s quelque peu insolite – a été remplacé par r (23). Le même phénomène s’est produit, d’ailleurs, dans arbos (arbre), labos (travail, labeur) et odos (odeur) qui sont devenus respectivement arbor, labor et odor. Par contre, dans les mots d’une seule syllabe, tels que flos – floris (fleur), mos – moris (moeurs) ou os – oris (bouche), le changement n’a pas eu lieu. À partir de cette série d’exemples, il serait maintenant possible de formuler cette analogie sous forme d’une « loi » : tous les noms terminés par –os et ayant –oris au génétif, s’ils ont plus d’une syllabe, changent –os en –or.
Si, dans le cas que nous venons de citer, le transformation de honos en honor relève clairement d’un phénomène d’analogie, nous pouvons nous imaginer des cas où la distinction entre loi phonétique et analogie est difficile, voire impossible. Lyons, sans donner d’exemple malheureusement, cite le cas hypothétique où une langue (ou dialecte) emprunte un ou plusieurs mots à une langue voisine (ou un dialecte voisin). Si ces mots présentent des configurations phonétiques particulières (dans le sens qu’elles sont inconnues ou inhabituelles dans la langue qui a fait l’emprunt), il est possible que, par un phénomène d’analogie, celles-ci se répandent dans toute la langue. Le linguiste qui analysera ensuite le phénomène dans une perspective « macroscopique » aura l’impression que ces changements ont été provoqués par une loi phonétique, quoique, en réalité, elles soient dues à une analogie(24).
Alors que les néogrammairiens considèrent que l’évolution d’une langue est entièrement déterminée par des lois phonétiques aveugles et mécaniques, les idéalistes – avec leur représentant principal Karl Vossler (1872-1949) – accordent une grande importance au rôle que l’individu joue dans le déclenchement et la diffusion des changements linguistiques. Selon eux, toute innovation est le produit d’une création individuelle qui, par la suite, a pu se répandre dans la communauté linguistique grâce à l’imitation par les autres locuteurs. L’individu serait, au moins jusqu’à un certain degré(25), conscient des innovations apportées par lui et celles-ci obéiraient à un principe esthétique universel. Le changement linguistique serait donc l’expression d’un goût personnel ou alors, lorsqu’il est partagé par toute la communauté, le reflet d’un sentiment national. Les idéalistes insistent aussi sur le rôle du statut social ou de l’influence littéraire : ainsi, certains auteurs, comme par exemple Dante en italien, sont mieux placés que d’autres pour provoquer des changements.
Tout compte fait, l’école idéaliste – courant philosophique plutôt que linguistique –, quoiqu’elle ait raison de rappeler que la langue n’est pas une entité supra-individuelle exposée à des changements sur lesquels les locuteurs n’ont aucune influence (tel que le préconise le dogme néogrammairien), exagère l’importance du facteur esthétique et surestime le travail prétendument conscient de l’individu. Son influence sur la linguistique historique a d’ailleurs été modeste.
Si l’école idéaliste s’était intéressée à la diffusion des innovations linguistiques à l’intérieur d’une communauté de locuteurs, la néolinguistique (ou linguistique spatiale), avec son principal représentant, l’italien Matteo Bartoli (1873-1946), s’intéresse à la diffusion de ces phénomènes dans l’espace. Bartoli se pose des questions sur la chronologie du lexique par rapport à sa distribution géographique, ainsi que sur les « centres d’irradiation » des phénomènes linguistiques. En prenant l’exemple des langues romanes, Bartoli distingue différentes zones schématiques du territoire : l’aire isolée (appelée aussi l’aire le moins exposée à la communication), l’aire latérale, l’aire majeure ou mineure et l’aire postérieure (par rapport à la colonisation du territoire)(26). Grâce à un travail essentiellement statistique, il est capable de formuler quelques conclusions en rapport avec ces aires : il constate, par exemple, que les aires isolée et latérale présentent, en général, un lexique plus archaïque (ainsi, pour le mot « cheval », on a ebba en Sardaigne (aire isolée), yegua et iapâ en Espagne et en Roumanie (aires latérales) – tous les trois dérivés du lat. EQUA – face à cavalla, d’un étimon hypothétique *CABALLA, en Toscane). Il en va de même pour les aires postérieures (ainsi, comer « manger », du lat. COMEDERE, en Espagne (aire postérieure) face à mangiare et manger, du lat. vulg. MANDUCARE, en Italie et en Gaule) et pour les aires majeures (des dérivés de CAPUT en Espagne, Italie et Roumanie (cabeza, capo, cap) face à tête, du lat. vulg. TESTA, en Gaule(27)). Bartoli est aussi un des premiers à réfléchir sur la provenance des innovations et la manière dont elles ont ensuite été « exportées » dans d’autres zones.
Même si la néolinguistique n’a jamais eu beaucoup d’importance dans l’histoire de la linguistique et que certaines de ses conclusions ont été refusées (telles les « lois » des aires majeure et postérieure qui semblent beaucoup moins acceptables que celle des aires isolée et latérale) elle a tout de même le mérite d’avoir introduit une perspective géographique et d’avoir réfléchi sur des phénomènes de migration.
Bartoli n’était pourtant pas le seul à avoir tenu compte des aspects géographiques : la linguistique géographique qui avait débuté avec L’Atlas linguistique de la France (publié entre 1902 et 1912) du linguiste suisse Jules Gilliéron (1854-1926) était déjà allée dans la même direction. Le principal intérêt de ces atlas linguistiques consistait à récolter une quantité maximale d’informations et à les représenter de manière cartographique afin qu’elles soient disponibles pour des recherches ultérieures. La linguistique géographique est intimement liée à l’onomasiologie (qui s’intéresse à la manière dont le même concept est exprimé dans différents dialectes ou langues) et à ce qu’on appelait le mouvement « des mots et des choses » (Wörter und Sachen). L’atlas que nous venons de citer, par exemple, contient une carte où figurent les différents mots qui désignent l’« abeille » en France avec leur distribution géographique.
La linguistique géographique s’intéresse avant tout au lexique et quoiqu’elle suive, en générale, une approche synchronique plutôt que diachronique, Gilliéron se demande pourquoi les formes ef (singulier) et es (pluriel), dérivées des accusatifs latins apem et apes « abeille », ont été remplacées par abeille (au sud et à l’ouest de la France), aveille (à l’est), mouche à miel (au milieu et au nord) et mouchette ou essette (dans certaines zones mineures)(28). Il arrive à la conclusion que ce remplacement est dû à une réduction excessive du matériel phonétique(29). Ce même processus de réduction, qui est une des principales caractéristiques dans l’évolution du latin au français, a aussi produit de nombreux homonymes : les deux mots latins PECTUS et PEIUS, parfaitement distinctifs dans la langue originelle, se sont transformés en pis en ancien français. Afin d’éviter des confusions, le mot le moins utilisé – dans ce cas pis dans le sens de « poitrine » (signification 1) – a été remplacé par un dérivé de *PECTORINA (un diminutif de PECTUS). Ce remplacement n’a été que partiel, puisque le mot pis1, après une restriction de sens qui est assez typique dans de tels cas, a adopté la signification « mamelle des bêtes laitières ». Gilléron a aussi démontré que certaines transformations avaient leur origine dans une affinité sémantique : ainsi, l’étymon hypothétique *FIMARIUM (ou *FEMARIUM) a d’abord donné l’évolution régulière femier (la forme est attestée au XIIe siècle). A la suite d’une « étymologie populaire », qui rapprochait ce mot de « fumer », femier – tout à fait à l’encontre des lois phonétiques – c’est alors transformé en fumier(30). De tous ces exemples, Gilliéron déduit que chaque mot a sa propre histoire et, par conséquent, sa propre étymologie.
En insistant sur l’aspect individuel de chaque étymologie, Gilléron se situe clairement aux antipodes de la théorie néogrammairienne. Si sa position est, certes, intéressante et qu’elle peut, en effet, être défendue dans certains, voire même dans beaucoup de cas (grâce aux exemples qu’il cite), il n’en reste pas moins vrai que des phénomènes tels que la réduction excessive de phonèmes, le conflit homonymique et l’étymologie populaire sont loin d’affecter tous les mots. Nous pourrions dire qu’à l’individualité étymologique s’oppose la régularité du changement phonétique (qui, elle, est garantie par un système phonologique, tel que nous le verrons), c’est-à-dire le fait que certains mots, de par les ressemblances partielles qu’ils présentent dans leur structure phonétique, partagent, au moins jusqu’à un certain point, une histoire commune.
La dialectologie se développe à peu près à la même époque que la linguistique géographique. En 1889, le linguiste allemand Georg Wenker (1852-1911), commence à récolter du matériel pour un atlas linguistique des dialectes allemands (un travail qui durera assez longtemps puisque la publication du matériel ne se fera qu’en 1927). Après que son collègue Herrmann Paul (1846-1921) eut précisé la théorie néogrammairienne en disant que les « lois phonétiques agissent sans exception à l’intérieur du même dialecte »(31), le but de Wenker, lui-même néogrammairien, était d’établir les frontières exactes des dialectes allemands afin de démontrer, une fois pour toutes, la justesse de cette hypothèse.
A la grande surprise de Wenker et de ses collègues, les résultats étaient diamétralement opposés à ce qu’ils avaient projeté de démontrer. Wenker avait essayé de déterminer les frontières dialectales à l’aide d’oppositions phonétiques telles qu’elles se présentent, par exemple, dans les mots allemands Dorp « village » vs Dorf, make « je fais » vs mache, ik « moi » vs ich, dat « cela » vs das et Appel « pomme » vs Apfel. Comme ces oppositions faisaient partie de la « deuxième mutation consonantique » (zweite Lautverschiebung), qui représente un changement assez fondamental dans le phonétisme allemand puisqu’il divise le bas-allemand du haut-allemand – on s’attendait à ce que les « isoglosses » (tel est le terme technique introduit par les dialectologues pour désigner la ligne qui circonscrit l’extension d’un phénomène linguistique) coïncident sur la carte. Il s’est avéré, cependant, qu’elles suivent, en général, des lignes assez irrégulières : si elles coïncident à certains endroits, elles peuvent s’éloigner considérablement à d’autres ou même ne pas coïncider du tout. Wenker constate aussi qu’il y a des variations d’un mot à l’autre comme si chacun d’entre eux avait eu son propre traitement(32).
Si les frontières des dialectes sont imprécises et qu’elles ne peuvent être déterminées avec exactitude, cela signifie en même temps que la notion de dialecte est à remettre en question. On était parti de l’idée que les dialectes se caractérisaient par certains traits qui leur étaient propres et qu’ils présentaient, par conséquent, une certaine homogénéité. La dialectologie, pourtant, a montré que cette unité dialectale n’existe pas en réalité : certains traits dépassent les « frontières dialectales » (s’il est encore approprié d’utiliser ce terme) et sont partagés par un ou plusieurs « dialectes » voisins ; d’autres, quoiqu’ils ne dépassent pas les limite du dialecte, ne s’étendent pas sur la totalité du territoire occupé par celui-ci.
Cette mise en question de l’homogénéité de la langue est soutenue par d’autres travaux qui ne relèvent pas directement de la dialectologie : déjà en 1891, l’abbé Pierre Rousselot (1846-1924) avait publié une monographie très célèbre – intitulée Modifications phonétiques du langage étudiées dans le patois d’une famille de Cellefrouin (Charente) – où il démontre que, même à l’intérieur d’une famille, la langue est sujette à des variations individuelles plus ou moins grandes(33). Évidemment, cette recherche a été d’une valeur fondamentale parce que si l’unité du langage n’est même pas garantie à l’intérieur d’une communauté linguistique aussi réduite que la famille, il est pratiquement exclu qu’elle existe au niveau dialectal.
Si la langue n’est pas une unité homogène, il faut alors la considérer plutôt comme un continuum où on peut trouver toute sorte de mélanges linguistiques. Cette idée a été formulée pour la première fois par le linguiste allemand Hugo Schuchhardt (1842-1927)(34). Schuchhardt, qui se proposait d’élaborer une classification des dialectes romans, s’était vu confronté à des problèmes considérables parce que, du point de vue scientifique, le concept même du dialecte lui semblait profondément vague et contestable(35). D’après lui, il fallait plutôt considérer les traits « dialectaux » comme des phénomènes linguistiques isolés qui, après avoir surgi à un point géographique très précis se sont répandus – un peu comme une onde sur une surface d’eau – sur un espace plus ou moins large suivant leur force ou leur intensité(36). Chaque innovation possède donc un « épicentre » à partir duquel elle se diffuse dans toutes les directions. Comme ces épicentres ne se trouvent pas forcément tous au même endroit et comme l’intensité, elle aussi, varie pour chaque innovation, on aura, à n’importe quel endroit sur la carte, un mélange assez hétérogène de toute une série de phénomènes linguistiques.
La « théorie des ondes » (tel est son nom officiel) a eu des implications considérables non seulement dans la manière dont on allait désormais concevoir l’évolution des langues, mais aussi dans la classification de celles-ci : Schleicher, dans son modèle d’arbre généalogique, était parti du principe que les langues évoluent en produisant des filiations directes dans le sens où la langue A a donné naissance à la langue B qui a donné naissance à la langue C etc. C’est-à-dire que, pour Schleicher, chaque langue fille a exactement une langue mère. Dans la théorie des ondes, par contre, comme les langues ne procèdent pas les unes des autres, mais que, dû à leur position ou leur distribution géographique, elles ont été touchées ou non par tel ou tel phénomène linguistique, elles peuvent parfaitement avoir des traits en commun avec plusieurs langues voisines. Tandis que les défenseurs de la théorie schleicherienne avaient mené de longs débats pour décider dans quelle branche de l’arbre généalogique il fallait placer telle ou telle autre langue, les adeptes de la théorie des ondes résolvent le problème en regroupant les langues dans des ensembles qui peuvent ensuite avoir des intersections plus ou moins grandes avec un ou plusieurs groupes(37).
Après les néogrammairiens, la théorie des ondes est à considérer, sans doute, comme une des innovations les plus importantes du XIXe siècle. L’idée de l’hétérogénéité et de la variation dans la langue sera poursuivie au XXe siècle notamment par la sociolinguistique qui introduira le terme de la « stratification » pour rendre compte de ces variantes individuelles et/ou sociales des langues.
La question de savoir comment on pouvait représenter le langage par des signes symboliques remonte aux temps les plus anciens, mais les réflexions systématiques sur le sujet ne commencent qu’au XIXe siècle. Au moment où les chercheurs se mettent à comparer différentes langues, écrites dans nombre d’alphabets, un besoin de trouver un système de transcription universelle se fait sentir(38). Vu l’imprécision de ces alphabets traditionnels la formule « à son unique, symbole unique» devient la nouvelle devise des chercheurs.
Dans une première phase, on se concentre sur l’élaboration d’une notation phonétique universelle qui représente les « sons » des langues avec autant d’exactitude que possible. Ces recherches aboutissent dans la création de l’Alphabet phonétique international (API) dans le dernier quart du XIXe siècle. Grâce à la combinaison de lettres (empruntées à l’alphabet traditionnel dans la plupart des cas) et de signes diacritiques, cet alphabet permet de représenter un maximum de sons avec un minimum de signes. Il s’agit donc d’une notation à la fois pratique (puisque les signes utilisés étaient souvent disponibles sur les machines à écrire) et économique(39).
Cette première approche exclusivement phonétique de la transcription, quoiqu’elle ait apporté beaucoup de nouveaux éléments à la linguistique, devait bientôt entrer dans une crise due à la nature même de l’objet de recherche : étant donné que, du point de vue physique, les « sons » d’une langue sont d’un nombre infini, aucune notation, quelque précise qu’elle se veuille, ne saura jamais les représenter tous. Il était clair, pourtant, que tous les « sons » n’avaient pas la même « valeur » à l’intérieur d’une langue : le linguiste anglais Sweet, par exemple, avait fait remarquer que certaines différences de sons étaient distinctives (dans le sens où elle permettent de distinguer deux mots différents, par exemple mer – fer en français), tandis que d’autres ne l’étaient pas (par exemple qui – quart, où le son [k] est réalisé de manière palatale ou vélaire en fonction de la voyelle qui suit)(40).
Les réflexions de Sweet marquent le début d’une période où l’on passe systématiquement de la phonétique à la phonologie. Celle-ci ne s’occupe donc plus des « sons » dans leur sens général, mais s’intéresse à la valeur qu’ils ont par rapport à une langue spécifique. Si les premières idées phonologiques sont sensibles à partir de 1879, il faudra un certain temps, jusqu’à ce que le terme « phonème » (issu du mot russe fonema) s’établisse dans la terminologie linguistique(41). Il recevra sa première définition scientifique dans le structuralisme qui, fidèle au dogme que tout, dans la langue, est différence, le considérera comme une unité phonétique minimale qui est phonologiquement distinctive.
Tandis que le structuralisme se contente de définir le phonème comme une espèce d’atome indivisible de la phonologie, l’école de Prague va plus loin et s’intéresse aux systèmes que les phonèmes forment entre eux. Il est évident qu’un ensemble de phonèmes, comme par exemple t–p–k–d–b–g, n’est pas seulement une liste linéaire de phonèmes (qui ne présente donc aucun type d’« ordre »), mais implique une structure dans le sens où les phonèmes s’organisent en sous-ensembles : ainsi, t–p–k s’opposent à d–b–g puisque les premiers sont sourds, tandis que les seconds sont voisés ; en même temps, t–d s’opposent à p–b et à k–g vu qu’ils sont respectivement dentaux, bilabiaux et vélaires. A l’aide d’une analyse componentielle, l’école de Prague essaie de déterminer les unités minimales – les traits « distinctifs » (ou « pertinents ») – qui sont à la base non seulement du phonème, mais de tout le système phonologique.
A partir de ces idées, Roman Jakobson, lui-même membre du cercle linguistique de Prague, développe une théorie qui identifie douze traits distinctifs qui entrent en opposition binaire : ainsi, s’opposent, par exemple, les traits [+vocalique] vs [–vocalique], [+consonantique] vs [–consonantique], [+occlusif] vs [+occlusif] etc. Selon lui, n’importe quel phonème de toute langue peut être défini par un ensemble de traits, dont chacun peut avoir une valeur positive ou négative. Dans la chaîne parlée, le phonème n’est donc rien d’autre qu’un « segment » qui se caractérise par un « ensemble de traits distinctifs simultanés »(42).
Bien que le modèle binaire de Jakobson semble suffisant dans l’ensemble, la phonétique expérimentale n’a pas tardé à signaler certaines de ses limites : la question principale était de savoir comment il fallait intégrer les éléments prosodiques (tels que l’intonation ou l’accent) dans le modèle. Certains linguistes tiennent à élargir le modèle en introduisant des phonèmes suprasegmentaux qui dominent les phonèmes segmentaux (qui équivalent au phonème traditionnel) et Firth développera, à partir de 1949, une analyse prosodique qui est aussi précise que complexe.
Mais Daniel Jones a signalé que de telles extensions ne sont pas nécessaires dans tous les cas : on peut s’imaginer parfaitement que l’accent ou même l’intonation se joignent directement aux phonèmes(43).
La conception du phonème comme « segment de traits distinctifs » a des effets rétroactifs considérables quant à la manière d’interpréter les lois phonétiques. Tandis que, dans une perspective phonétique, celles-ci se présentent comme des transformations « en bloc » des sons, la perspective phonologique suggère de les concevoir comme une modification qui affecte un ou plusieurs traits distinctifs des phonèmes, c’est-à-dire comme une transformation partielle de ceux-ci.
Cette manière de voir les choses a en effet des conséquences surprenantes. Si nous prenons les exemples latins VITA, SECURUM et SAPERE, qui ont donné vida, seguro et saber en espagnol, nous voyons qu’aux trois consonnes occlusives sourdes /t/, /k/ et /p/ correspondent les trois consonnes occlusives sonores /d/, /g/ et /b/ de la façon suivante(44) :
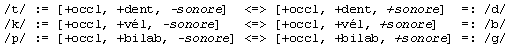
Si nous formulons une loi phonétique qui dit que n’importe quelle consonne occlusive sourde en position intervocalique change le trait [-sonore] en [+sonore], nous avons non seulement une loi phonétique très économique, mais, en même temps, nous mettons en évidence qu’il existe une corrélation entre les trois changements.
Ceci est, en soi, déjà admirable, mais la perspective phonologie nous mène encore plus loin. On peut supposer que lorsque /t/, /k/ et /p/ se sont sonorisés, ils sont entrés en conflit avec les consonnes /d/, /g/ et /b/ qui existaient déjà dans la langue. La question est de savoir si un tel conflit est tolérable ou non. Si nous regardons les évolutions lat. VIDERE > esp. ver, lat. REGALEM > esp. real, nous voyons que dans deux des trois cas au moins, /d/ et /g/ ont disparu(45). On peut donc supposer que la sonorisation de /t/, /k/ et /p/ et la perte de /d/ et /g/ ne sont pas des phénomènes indépendants, mais liés. Cette supposition peut être confirmée par une troisième série d’exemples : les mots BATTIRE /bat:ire/, BUCCA /buk:a/ et CUPPA /kup:a/, qui contiennent tous une consonne occlusive sourde tendue, ont abouti à batir, boca et copa. Nous avons donc ici le même conflit phonématique entre les évolutions de /t:/, /k:/, /p:/ et /t/, /k/, /p/ qui existaient déjà dans la langue. Schématiquement, la situation se présente donc comme suit :
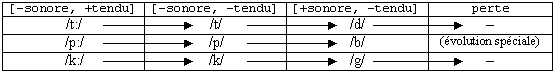
La phonologie met donc en évidence que les changements linguistiques ne sont pas des phénomènes isolés. Comme ils se produisent à l’intérieur d’un système, chaque transformation se répercute sur le système entier et elle est donc en même temps effet et cause des autres changements. C’est à partir de là que l’on a parlé de « pression structurelle »(46).
La question importante qu’il faut se poser, est celle de savoir où, à quel point exact du système, les transformations se produisent. Si nous partons du principe qu’il y a, d’un côté, des « sons », et, d’un autre, un système phonologique (à travers lesquels les « sons » doivent « passer » – un peu comme par les mailles d’une grille – lors de leur réalisation concrète), on peut se demander, en effet, si c’est les « sons » qui changent (et qui, dans ce cas, passeraient par une « maille » plutôt que par une autre), ou si, au contraire, c’est le système qui change (dans ce cas, la « grille », les « mailles » et, par conséquent, les « sons » se transformeraient en même temps). Schématiquement, les deux possibilités se présentent de la façon suivante(47) :

Dans le premier cas (fig. 1), la transformation aurait un caractère abrupte (ou discontinu), tandis que dans le deuxième (fig. 2), elle serait continue (ou « discrète », pour utiliser le terme mathématique).
Il se trouve que les changements linguistiques peuvent être des deux types : lorsque les voyelles brèves du latin classique se transforment en voyelles ouvertes, il est fort probable que le changement soit du type 2. Par contre, si, par une étymologie populaire, le mot espagnol vagabundo passe à vagamundo (à cause d’une affinité sémantique avec le verbe vagar « errer » et le substantif mundo « le monde »), il est évident que le changement de /b/ en /m/ est plutôt abrupte et constitue donc un « saut » d’une case phonologique à une autre.
La phonologie a donc introduit une perspective structuraliste dans l’évolution des sons : ceux-ci sont intimement liés à un système homéostatique(48) qui, dû à l’action de différentes tendances parfois opposées entre elles (cf. les principes de l’effort minimale, de la régularisation, de l’univocité du message etc.), est en constante réorganisation.
Dans ce bref aperçu historique, nous avons essayé, d’une manière assez sommaire, d’ailleurs, de présenter les principales idées et théories qui ont été formulées dans le domaine de la linguistique diachronique. Nous avons montré les différents aspect du terme de la « loi phonétique » en passant de la simple « tendance » (comparatistes) à la « loi absolue » (néogrammairiens), de la « validité dialectale » (Wenker) à la « diffusion concentrique » (Schuchhardt et « la théorie des ondes ») et du « phénomène phonétique » (comparatistes, néogrammairiens) au « système phonologique » (structuralistes). Nous avons montré, aussi, au moins deux points de vue diamétralement opposés : d’un côté, le pôle « déterministe » (comparatistes, néogrammairiens) qui érige la régularité et l’universalité de l’évolution diachronique en principe suprême, de l’autre côté, le pôle « individualiste » (idéalistes, la linguistique géographique), qui accorde une grande importance à la faculté créatrice du locuteur ou à l’histoire particulière des mots (le mouvement « les mots et les choses »). Nous avons aussi eu l’occasion de présenter quelques réflexions concernant la diffusion des phénomènes linguistiques (idéalistes, Bartoli et la néolinguistique, Schuchhardt et « la théorie des ondes »).
Face à cet ensemble assez hétérogène de théories, il est évident que toutes ne peuvent pas avoir raison et que certaines sont forcément plus justes que d’autres. Nous pourrions donc dire, avec Aristote, que la vérité se trouve quelque part au milieu, encore que nous osions prétendre que ce ne sera pas, cette fois-ci, la moyenne arithmétique puisque certaines théories paraissent nettement plus correctes que d’autres. Un des buts d’ETYMO consiste justement à apporter quelques réponses à ces questions.
1 Robins, op. cit., 1976, p. 140.
2 On peut mentionner les deux grammaires sanscrites, celle de W. Carey (Grammar of the Sungskrit language, publiée en 1806), d’une part, et celle de W. Carey (Grammar of the Sanskrita language, publiée en 1808), d’autre part. L’ouvrage Über die Sprache und Weisheit der Inder de Friedrich Schlegel, publié en 1808, incite explicitement les savants européens à s’intéresser davantage à cette langue.
3 Bopp hésite encore entre « tronc sanscrit » (« sanskritischer Sprachstamm »), « le sanscrit et les langues qui lui sont apparentées » (« das Sanskrit und die mit ihm verwandten Sprachen ») et « indisch-europäisch ». Tagliavini, op. cit., tome I, 1963, p. 56.
4 Robins, op. cit., 1976, p. 26 – 27.
5 Nous adoptons ici la traduction – quelque peu imprécise, mais largement canonisée dans les ouvrages français – de la « mutation consonantique ». Robins 1976, p. 180. La traduction est légitime dans la mesure où la « loi de Grimm » ne tient compte que des consonnes.
6 L’appelation est due à Pott qui l’utilise pour la première fois en 1833. Signalons que les mêmes correspondances avaient déjà été découvertes et décrites par Rask en 1818. Son oeuvre n’a malheureusement pas reçu l’apréciation qu’elle aurait mérité par le simple fait qu’elle était peu connue à l’époque.
7 Tagliavini, op. cit., tome I, 1963, p. 84.
8 Robins signale que la « Stammbaumthéorie » présente aussi des points communs avec les méthodes utilisées pour reconstruire la généalogie des manuscrits que Schleicher peut avoir connues à travers F. Ritschl, qui était un de ses professeurs. Robins, op. cit., 1976, 188.
9 Tagliavini, op. cit., tome I, 1963, p. 102.
10 Tagliavini, op. cit., tome I, 1963, p. 103.
11 Tagliavini, op. cit., tome I, 1963, p. 102. Bopp avait, à son tour, formulé des idées assez semblables. Il écrit : « Die Sprachen sind als organische Naturkörper anzusehen, die nach bestimmten Gesetzen sich bilden, ein inneres Lebensprinzip in sich tragend sich entwickeln, und nach und nach absterben » (cité dans Robins 1976, p. 192). La vision de la langue comme un « corps organique naturel » (organischer Naturkörper) qui comporte un « principe inhérent de vie » (inneres Lebensprinzip), ainsi que l’idée de l’évolution (naissance, maturité, déclin) ne diffèrent en rien de la théorie schleicherienne.
12 Tagliavini, op. cit., tome I, 1963, p. 95.
13 Tagliavini, op. cit., tome I, 1963, p. 96.
14 Robins, op. cit., 1976, p. 198.
15 Robins, op. cit., 1976, p. 194.
16 Verner dans son article « Eine Ausnahme der ersten Lautverschiebung », cité par Robins, op. cit., 1976, p. 195.
17 Robins, op. cit., 1976, p. 194 – 195.
18 Osthoff et Brugmann cités dans Robins, op. cit., 1976, p. 196.
19 Osthoff et Brugmann cités dans Robins 1976, op. cit., p. 196. Ces remarques vont évidemment dirigées contre Schleicher et sa reconstruction de l’indo-européen. A noter le ton polémique de ces phrases (qui est malheureusement typique et qui explique dans une large mesure les réactions indignées et véhémentes des contemporains auxquelles nous avons fait allusion dans le texte) qui est encore plus sensible dans le texte original (cf. « [Nur wer] aus dem hypothesengeschwängerten Dunstkreis der Werkstätte, in der man die indogermanischen Grundformen schmiedet, einmal heraustritt [..], um hier sich Belehrung zu holen über das, was die graue Theorie nimmer erkennen lässt... »). C’est nous qui soulignons.
20 Robins, op. cit., 1976, p. 197.
21 « Per analogia si intende il ravvicinamento concettuale di una forma ad un’altra », Tagliavini, op. cit., tome I, 1963, p. 180. Le terme « conceptuel » est ici délibérément flou et peut donc se référer à toute une série de phénomènes assez divers : des parallélismes ou des oppositions sémantiques, l’influence d’un paradigme grammatical, une ressemblance phonétique etc.
22 Ainsi, la forme « vous *disez » au lieu de « vous dites » – analogique, par exemple, à « vous lisez » et qui apparaît dans la forme composée « vous contredisez ») – est considérée comme une évidente erreur de conjugaison. La grammaire normative parle aussi de « fausse analogie ». Tagliavini, op. cit., tome I, 1963, p. 179.
23 Souvent, on schématise les analogie sous forme d’équations du type cultoris – cultor : honoris – x où il s’agit donc de trouver l’inconnue x (le signe « : » voulant dire « se trouve dans le même rapport que »).
24 Lyons, op. cit., 1975, p. 33.
25 Croce, un des maîtres à penser de ce mouvement, affirme que même si l’individu est inconscient sur le moment, son intuition esthétique ne le trompe jamais et le conduit toujours à « créer » ce qui, après, correspond parfaitement à ses goûts. Vossler, quant à lui, considère que l’artiste autenthique ne fait que « pousser plus loin ce que tout être humain fait à chaque instant ». Robins, op. cit., 1976, p. 202.
26 Sauf pour l’expression « area seriore » que nous avons traduit par « aire postérieure », nous avons gardé les termes italiens (« area isolata o area meno esposta alle comunicazioni », « area laterale », « area maggiore / minore »). Tagliavini, op. cit., tome I, 1963, p. 296.
27 Notons que ce n’est que pour des raisons d’intégrité que nous avons cité la loi de l’aire majeure puisque celle-ci est la plus contestée. En effet, les exemples que nous citons ici contiennent une contradiction évidente puisque le mot « chef », dérivé de CAPUT (ou d’une forme hypothétique *CAPUS ou *CAPUM), existe bel et bien en français.
28 Carte reproduite dans Tagliavini, op. cit., tome I, 1963, p. 264.
29 Tagliavini, op. cit., tome I, 1963, p. 262.
30 Tagliavini, op. cit., tome I, 1963, p. 269.
31 Tagliavini, op. cit., tome I, 1963, p. 207.
32 Tagliavini, op. cit., tome I, 1963, p. 254.
33 Tagliavini, op. cit., tome I, 1963, p. 253.
34 Schuchardt a exposé cette idée bien avant l’apparition de la théorie néogrammairienne lors de son cours inaugural à Leipzig en 1870. Cependant, elle ne fut publiée que 30 ans plus tard dans Über die Klassification der romanischen Mundarten. Tagliavini, I, p. 208. Son collègue Johannes Schmidt (1843-1901), l’avait formulée de son côté en 1872 dans son travail Die Verwandtschaftsverhältnisse der Indogermanischen Sprachen. Tagliavini, op. cit., tome I, 1963, p. 409.
35 Tagliavini, op. cit., tome I, 1963, p. 207.
36 La métaphore de l’onde sur l’eau provient du même Schuchhardt qui écrit : « Denken wir uns in ihrer Einheit als Gewässer mit glattem Spiegel : in Bewegung gesetzt wird dasselbe dadurch, dass an verschiedenen Stellen desselben sich Wellencentra bilden, deren Systeme, je nach der Intensivität der treibenden Kraft von grösserem oder geringerem Umfange, sich durchkreuzen ». C’est nous qui soulignons. Tagliavini, op. cit., tome I, 1963, p. 412.
37 Voir Tagliavini, op. cit., tome I, 1963, p. 408.
38 Robins, op. cit., 1976, p. 210.
39 Ces deux avantages expliquent le succès de cette notation. Le phonéticien anglais Sweet avait, lui aussi, créé une notation, mais, comparée à l’API, elle était complètement illisible pour le non-initié et elle ne pouvait pas être représentée sur une machine à écrire traditionnelle. Tagliavini, op. cit., tome II, 1963, p. 117.
40 Robins, op. cit., 1976, p. 212.
41 Gabriel Bès, « Phonem », ds : Martinet, op. cit., 1973, p. 206.
42 Robins, op. cit., 1976, p. 237.
43 Robins, op. cit., 1976, p. 227ff. Nous reviendrons plus en détail sur ces aspects lorsque nous parlerons du modèle phonologique d’ETYMO.
44 Pour des raisons d’espace typographique, nous omettons le trait [+consonantique] et nous abrégeons les traits [+occlusif], [+dental], [+bilabial] et [+vélaire].
45 Nous laissons de côté l’évolution du /b/ latin qui est plus compliquée et qui, pour de nombreuses raisons, a suivi d’autres principes que ceux que nous voulons exposer ici. Notons que les évolutions phonétiques sont présentées de manière très simplifiée (avant la perte de /d/ et /g/, par exemple, il y a d’abord eu fricativisation des deux phonèmes /ð/ et /g/), mais cela n’affecte en rien les mécanismes généraux que nous nous proposons de présenter ici.
46 Lyons, op. cit., 1975, p. 38. L’expression « pression structurelle » ne se réfère pas seulement au système phonologique, mais s’applique aussi à des transformations telles que honos > honor (que nous avons présenté plus haut) où la pression vient d’une régularisation analogique grammaticale. En effet, tout système sous-jacent est susceptible d’exercer une telle pression. Signalons que dans les évolutions /t/ > /d/, /k/ > /g/ et /p/ > /b/, la pression structurelle n’est pas la seule explication du changement : vu que les consonnes se trouvent en position intervocalique, l’assimilation a aussi joué un rôle non négligeable.
47 Il s’agit effectivement de schémas très approximatifs. Dans la figure 2, par exemple, nous n’avons qu’esquissé la transformation d’une seule ligne. Il est évident que les autres lignes se transformeraient en même temps.
48 Lyons, op. cit., 1975, p. 92.
| Retour à la page principale | << Chapitre précédent | Chapitre suivant >> |